Dépêches de Lockdown: réflexions d’un journaliste d’art
En visitant un musée à Berne, en Suisse, il y a plusieurs années, j’ai vu une exposition d’œuvres créées pendant la peste bubonique, une pandémie survenue en Europe au 14e siècle. Le spectacle se composait de plusieurs dizaines de dessins de style caricature, illustrés par un artiste inconnu. En regardant cet affichage inhabituel, j’ai été frappé par la gamme de personnages qui ont vécu et sont morts du virus rampant. Avec des pauvres, des bouffons de cour et des courtisanes, il y avait des chevaliers, des rois et des chefs d’église estimés.
De même, comme notre pandémie COVID-19 l’a prouvé, il n’y a pas d’obstacles sociaux à ce fléau dévastateur et parfois mortel. Parmi les personnes infectées figurent des membres de la famille royale, des politiciens, des stars de cinéma, des musiciens, des présentateurs de télévision, des athlètes, des médecins et des infirmières, ainsi que des travailleurs d’usine et de restauration et des prisonniers. Même ceux qui ont échappé à l’infection restent à la maison, manquant de la camaraderie et de l’hyper-connectivité des activités de groupe, y compris les événements sportifs et musicaux, et dans mon cas, les ouvertures de musées et de galeries et les foires d’art.
Comme l’a écrit Jason Farago dans le New York Times le 25 mars 2020, «Pas de musées, pas de galeries, pas de foires, pas d’écoles d’art; pas d’ouvertures, pas de visites d’ateliers, pas de disputes sur les bières, pas de partenariats de jet privé gauche… le monde de l’art contemporain est passé d’un réseau mondial réverbérant à une ville fantôme, s’abritant sur place car le coronavirus met en danger nos villes et nos moyens de subsistance.
Je regarde par mes fenêtres le printemps florissant, les fleurs sauvages en prolifération, en voyant le monde à travers l’air nouvellement cristallin, maintenant relativement peu sali par la pollution. Pourtant, non loin de mes fenêtres, se cachent des germes qui pourraient me rendre très malade, voire me tuer.
Faire des promenades dans mon quartier, voir des gens marcher, courir, faire du vélo, promener des chiens, s’amuser, je pense au film de 1959, Sur la plage, avec Gregory Peck, Tony Perkins et Ava Gardner. Le film, qui se déroule en Australie pendant une guerre nucléaire mondiale, dépeint des résidents locaux qui reconnaissent que leur île bucolique est le seul endroit sur Terre qui n’a pas encore été touché par les retombées nucléaires. Pourtant, alors que ces citoyens tentent de se comporter normalement, ils savent que les retombées atteindront leur île dans quelques mois et finiront par les détruire tous.
Je suis l’actualité avec une grande intensité, souvent étonnée par le nombre croissant de cas et de décès dus à la pandémie de coronavirus. Je me demande si le virus finira par m’atteindre, mes amis ou connaissances, tout comme les retombées nucléaires se dirigeaient vers les joueurs de Sur la plage. Des vidéos de la scène finale de ce film dépeignent une rue de la ville dépourvue de monde, tandis qu’une seule feuille de papier est soufflée. De même, les présentateurs de nouvelles diffusent des images de Times Square, désormais pour la plupart dépourvues de monde.
Lorsque je quitte mon quartier, je suis frappé par l’absence relative de voitures sur la route et de gens sur les trottoirs. Je conduis sur Pacific Coast Highway et je vois des magasins, des galeries d’art et des concessionnaires automobiles tous illuminés. Pourtant, leurs portes sont fermées car leurs entreprises sont au point mort. Ces scènes me rappellent l’art mystérieux du milieu du siècle des surréalistes Max Ernst, Salvador Dalí, René Magritte et d’autres qui dépeignaient un monde étrange, insaisissable et inconfortable.

John Upton, Japanalia: Swimming Shaman (avec la permission d’Orange Coast College)
En tant que journaliste d’art, j’ai adoré assister aux vernissages d’expositions et rencontrer des artistes, des conservateurs et des administrateurs d’art. À tel point qu’aujourd’hui je me sens dépourvu des ordres de séjour à la maison bien que je comprenne leur raison d’être. Je m’assois chez moi au sommet d’un canyon avec de bons souvenirs de mes récents dialogues et interactions avec des artistes et des conservateurs. Je pense également aux nombreuses expositions que j’ai visitées l’année dernière dans des lieux à travers le pays et au-delà, et je réfléchis à la joie de voir ces expositions d’art et les nombreuses pièces exquises qu’elles contiennent.
Bien qu’il existe de nombreuses possibilités de regarder l’art en ligne, voir l’œuvre numériquement ne remplace pas la sensation de voir les œuvres d’art tangibles, de ressentir par procuration l’énergie, la motivation et l’intention des artistes. En repensant à l’année dernière, j’ai publié près de quatre douzaines d’articles liés à l’art, dont trois pour le L.A. Hebdomadaire. Parmi l’art sur lequel j’ai écrit pour cet article, il y a l’art textile des Arpilleras du Chili à motivation politique, les peintures sensuelles et érotiques de l’artiste autrichienne Katherina Olschbaur et la photographie classique et contemporaine de John Upton.

Arpillerista A.P.A Arrests and Raids, 1976, Textile brodé, 15 x 19 ½ pouces (Gracieuseté de Margaret Beemer | MOLAA)
En tant qu’écrivain d’art, j’ai hâte de reprendre là où je m’étais arrêté il y a quelques mois. Je me rends également compte que le monde que je connais sera radicalement différent lorsque nous nous remettrons de ce fléau et du ralentissement économique qui en résultera. Je me demande comment les nombreux musées et galeries que j’ai visités s’en sortiront – ou s’ils existeront même – une fois que nous reviendrons à un état dit normal. En tant qu’éditeur avec qui j’ai travaillé récemment, nous avons remarqué que nous sommes dans un nouveau paradigme culturel. Bien qu’il n’ait pas dit ce qu’est ce nouveau paradigme, il a fait allusion au fait que pendant ces périodes de fermeture, les écrivains d’art pourraient élargir leurs horizons et écrire sur des sujets qui enflamment leurs passions.
Bien que mes passions soient nombreuses, je me retrouve souvent à regarder au-delà de l’immédiateté de l’art sur lequel j’écris et des situations spécifiques dans lesquelles je suis, pour une vision du monde plus large. Je me souviens avoir vu une exposition l’année dernière au Baltimore Museum of Art, intitulée «Monstres et mythes: surréalisme et guerre dans les années 30 et 40». Cette exposition d’œuvres d’artistes tels que Dali, Pablo Picasso, Max Ernst et Andre Masson, était basée sur l’idée que les monstruosités du monde réel élèvent des monstres dans une variété de formes d’art, produisant un travail d’une créativité exceptionnelle.
Cette pandémie – et le désengagement corporel et la situation politique qui en résultent – est la pire crise nationale et mondiale que j’ai personnellement connue. En dialoguant avec un groupe d’artistes récemment sur Zoom, j’ai exprimé cette opinion, tout en faisant allusion à la pertinence actuelle de l’exposition Surréalisme que j’ai vue l’année dernière. Comme la plupart des artistes étaient d’accord avec cette évaluation, je m’attends à ce que lorsque cette pandémie sera terminée, nous découvrirons que les gens du monde de l’art ont produit des œuvres qui expriment non seulement l’époque dans laquelle nous vivons, mais – comme avec le mouvement surréaliste – ont produit des œuvres d’art exceptionnelles. J’ai hâte de voir ce travail et d’écrire à ce sujet.

Katherina Olschbaur, Dirty Elements aux University Art Galleries, UC Irvine (Photo Jeff McLane Studio, Inc.)



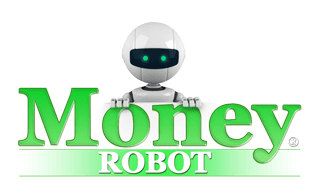


Commentaires récents