Agonie et extase sur l’archipel écossais de St. Kilda
Pendant la première heure environ, l’eau était relativement calme. Après avoir quitté le petit village de pêcheurs de Stein sur l’île de Skye, nous avons traversé un détroit connu sous le nom de Little Minch vers la bande principale des Hébrides extérieures, l’épaisse boucle de rochers qui plane comme une apostrophe sur la côte nord-ouest de l’Ecosse continentale.
Mais alors que nous avancions, voyageant vers l’ouest au-delà des îles de Nord de l’Uist et Lewis et Harris, l’eau est soudain devenue plus agitée. Ici, complètement exposés dans l’océan Atlantique Nord, nous n’avions aucun refuge contre la houle : toutes les quelques secondes, pendant plus de deux heures, la coque de notre bateau d’excursion claqué contre les vagues venant en sens inverse avec assez de force pour me faire claquer des dents.
J’ai regardé à ma droite, de l’autre côté de l’allée étroite du bateau, et j’ai vu mon frère et ma sœur inconfortablement blottis dans leurs sièges. Aucun de nos compagnons de voyage – nous étions environ 12, au total, entassés dans un bateau étonnamment petit – n’avait l’air heureux. Mais mes frères et sœurs, serrant leurs sacs de vomi jetables, avaient l’air malades.
(« C’est un euphémisme, c’est mal », a raconté ma sœur Emelia en riant. « Je dirais que nous avions l’air condamnés. »)
Pendant des siècles, l’archipel de St. Kilda, l’une des régions les plus reculées des îles britanniques, a électrisé l’imaginaire des écrivains, historiens, artistes, scientifiques et aventuriers.
À environ 40 miles à l’ouest des principales îles des Hébrides extérieures, St. Kilda a une histoire alléchante, riche d’un riche patrimoine culturel, d’un peuple farouchement indépendant, d’une architecture distinctive et d’un isolement obsédant – ainsi que de maladies, de famine et d’exil.
Des recherches archéologiques récentes suggèrent que l’île principale, Hirta, qui mesure environ 2,5 miles carrés, a été habité il y a 2000 ans. Ses derniers résidents à temps plein, 36 au total, étaient évacué vers le continent le 29 août 1930, leur communauté et leur mode de vie étant devenus insoutenables.
Désigné comme un double Patrimoine mondial de l’UNESCO pour son importance naturelle et culturelle, St. Kilda est maintenant détenue, gérée et protégée par le National Trust for Scotland, dont le personnel – parfois aux côtés d’autres bénévoles et chercheurs – occupe Hirta pour plusieurs mois de l’année. Les entrepreneurs du ministère britannique de la Défense passent également du temps sur l’île, où ils exploitent une station radar.
Pendant la majeure partie de son histoire habitée, St. Kilda était un voyage de plusieurs jours à travers l’océan depuis ses colonies voisines les plus proches. La menace de violentes tempêtes – particulièrement fréquentes entre les mois de septembre et mars – a rendu le voyage intimidant dans le meilleur des cas et impensable dans le pire des cas.
Même aujourd’hui, les horaires des bateaux sont soumis aux caprices des prévisions, et les annulations par les voyagistes ne sont pas inhabituelles. Lorsque mes frères et sœurs et moi avons visité fin août 2018, nous avons dû décaler notre voyage d’une journée de manière préventive pour éviter une période imminente de mauvais temps qui arrive plus tard dans la semaine.
Les caractéristiques naturelles de St. Kilda sont presque comiques dans leur splendeur. Des piles de mer déchiquetées s’élèvent comme des couteaux empaquetés de l’eau opaque ; des oiseaux de mer hurlants flottent nonchalamment au-dessus des falaises abruptes ; des champs plongeants recouvrent un paysage d’un autre monde totalement dépourvu d’arbres.
Et pourtant, ce sont les vestiges architecturaux de St. Kilda qui ont discrètement fait allusion aux éléments les plus dramatiques de son histoire.
Avec une population qui a culminé à environ 180 personnes à la fin du XVIIe siècle, St. Kilda n’a jamais été une maison pratique. Ses habitants élevaient des moutons et quelques bovins et pouvaient souvent cultiver des cultures simples comme l’orge et les pommes de terre. Mais l’essentiel de leur alimentation venait de la sauvagine : les œufs des oiseaux, ainsi que les oiseaux eux-mêmes, qui étaient consommés à la fois frais et salés. (La pêche était souvent peu pratique en raison de la trahison des eaux environnantes ; les insulaires ont également exprimé une nette préférence pour le fou de Bassan, le fulmar et le macareux par rapport au poisson.)
Les villageois ont attrapé les oiseaux et ont ramassé leurs œufs – à l’aide de longues perches et de leurs mains nues – en s’abaissant sur des cordes au sommet des falaises des îles, ou en escaladant les parois rocheuses de l’eau ci-dessous.
En contemplant les cheminées de l’archipel depuis un bateau qui tangue dans l’océan glacial, j’ai essayé d’imaginer les circonstances dans lesquelles de tels extrêmes seraient nécessaires simplement pour savourer un repas monotone. Il a testé les limites de mon imagination.
La vie à St. Kilda était une expérience angoissante dans la précarité. Le temps orageux a gâché les récoltes, menacé les magasins de nourriture, empêché la chasse à la volaille et retardé les travaux nécessaires. Débarquer un bateau à Hirta’s Village Bay, le site de la colonie de longue date de l’archipel, pourrait être difficile même par temps idéal. Les maladies, notamment la variole, le choléra, la lèpre et la grippe, se propagent rapidement et avec des effets dévastateurs. Pendant des décennies, St. Kildans a parfois lancé son courrier à l’aveuglette dans la mer dans de petits conteneurs étanches ; l’espoir était que leurs « bateaux postaux », comme on les appelait, pourraient par hasard atteindre un endroit peuplé ou être ramassés et envoyés par un navire de passage.
L’isolement extrême des insulaires a également engendré un type particulier de déconnexion culturelle. Dans son livre de 1965 « La vie et la mort de St. Kilda », l’auteur Tom Steel décrit une scène dans laquelle un St. Kildan s’est échoué sur les îles voisines de Flannan :
Il entra dans ce qu’il croyait être une maison et commença à monter les escaliers – des objets en pierre qu’il n’avait jamais vus de sa vie, mais qu’il prit pour l’échelle de Jacob. Il atteignit le sommet et entra dans la pièce brillamment éclairée. « Êtes-vous Dieu Tout-Puissant ? demanda-t-il au gardien du phare. « Oui », fut la réponse sévère, « et qui diable êtes-vous ? »
Et pourtant, St. Kildans était souvent décrit dans les récits contemporains comme particulièrement joyeux. La criminalité était pratiquement inexistante. Les fournitures et les dons apportés du monde extérieur – ainsi qu’une grande partie de la nourriture collectée sur les îles – ont été répartis équitablement entre les insulaires. Des objets tels que des bateaux et des cordes, dont dépendait la survie de la colonie, appartenaient et étaient entretenus en commun.
Lorsque l’écrivain écossais Martin Martin a visité l’archipel en 1697, il a noté le caractère joyeux des gens. « Les habitants de St. Kilda sont beaucoup plus heureux que la plupart des hommes, écrit-il, car ils sont presque les seuls au monde à ressentir la douceur de la vraie liberté.
En fin de compte, cependant, la vie à St. Kilda s’est avérée intenable. Le marché des exportations des insulaires — plumes, tweed, mouton, huile d’oiseau de mer — s’est progressivement affaibli. Les taux de mortalité infantile étaient étonnamment élevés. À défaut de suivre le rythme du confort et des technologies du continent, les îles sont devenues de plus en plus anachroniques et les habitants de plus en plus isolés.
Un hiver particulièrement rigoureux en 1929 et 1930 scella le destin de St. Kildans. Craignant la famine, ils ont demandé au gouvernement d’être évacués.
Même cela, cependant, n’a pas suffi à briser le charme d’Alexander Ferguson, l’un des évacués, qui, des années plus tard, décrivant St. Kilda dans une lettre, a écrit qu’« il n’y a pas de paradis sur terre comme celui-ci ».
« Pour moi, vivre en paix à St. Kilda », a dit un jour Malcolm Macdonald, un autre résident de longue date. « Et pour moi, c’était le bonheur, cher bonheur. »
Quatre heures après notre arrivée, après avoir erré sur le terrain vallonné de Hirta et flâné tranquillement le long de sa coquille creuse de village, nous nous sommes alignés le long de la jetée de l’île et sommes montés à bord d’un canot pour retourner à notre bateau. Notre voyage vers l’est, retour à Skye, a été plus fluide, plus calme, plus calme. Pendant une longue période, un groupe de dauphins a nagé à nos côtés, comme pour nous escorter à travers l’eau.
Lorsque nous avons finalement atteint Stein, j’ai ressenti une pointe de perte. Ce n’est qu’alors que j’ai commencé à comprendre ce qui a poussé plusieurs des 36 insulaires, partis en 1930, à revenir vivre temporairement à Hirta à l’été 1931 : une certitude grandissante que le plaisir d’errer librement parmi les îles, entouré par l’océan sans limites, valait la peine d’être – et d’être – là-bas.

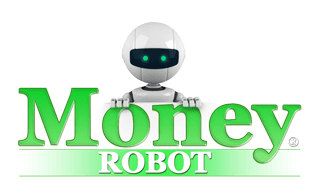


Commentaires récents